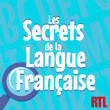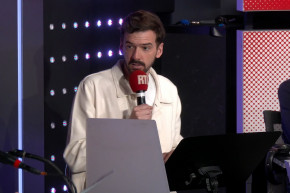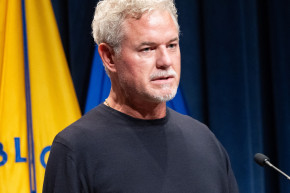- 02m47s
2 min de lecture
Le français, une langue "vachement" agricole
Les expressions issues de la terre sont parmi les plus charmantes de notre langue. Le florilège animalier de Muriel Gilbert…

Une vache (illustration)
Crédit : wolfgang-hasselmann/unsplash
À l’occasion du Salon de l’agriculture, amis des mots, je vous ai concocté un Bonbon sur la langue… agricole. Vous n’imaginez pas à quel point la langue que nous parlons est liée à l’agriculture. Nos expressions, en particulier, qui font toute la saveur du français, sont en grande partie nées de la terre.
Tout simplement parce que la plupart d’entre elles ("Il en a du blé, celui-là !", "Tu vas me rendre chèvre !", "Dis donc, on n’a pas gardé les cochons ensemble !", "N’en fais pas tout un fromage !", ou même "L’équipe de RTL Matin Week-End se couche avec les poules"), sont nées à une époque où les Français étaient des agriculteurs… Jusqu’au milieu du XXe siècle, la France était un pays de paysans.
Or, ce sont surtout les animaux de la ferme qui ont inspiré nos ancêtres. On commence à la porcherie ? Les cochons sont réputés aimer vivre dans la boue, peut-être qu’ils préféreraient une chambre d’hôtel bien nette, mais c’est cette réputation qui fait que l’on dit de quelqu’un de peu ragoutant qu’il est sale comme un cochon, ou qu’il est un cochon tout court, ou qu’il se livre à des cochonneries - mais là il est davantage question d’actes que la morale réprouve.
Tête de cochon ou tête de lard ?
On parle aussi parfois d’une tête de cochon, ou d’une tête de lard, son synonyme en tranches, si j’ose dire (pauvre cochon). Mais passons au poulailler : si votre maman est une "mère poule", si elle vous appelle tendrement "mon poussin" ou "mon canard", ou si dans nos cours de récré on se traite encore parfois de "poule mouillée", c’est bien parce que notre langue a grandi dans la basse-cour. Toujours rayon volaille, on peut "être fier comme un coq" ou "comme un paon".
Mais l’animal qui le plus emblématique de nos campagnes, de notre agriculture et de nos expressions, c’est la vache. D’ailleurs, c’est une jolie salers, Ovalie, qui est la mascotte du Salon de l’agriculture 2023. Pourtant, à en juger par les expressions qui parlent des vaches, le français est bien ingrat vis-à-vis d’une espèce si paisible.
Pour commencer, quand on dit que quelqu’un est vache, ce n’est pas un compliment… Et quand on dit que c’est "une peau de vache", c’est encore pire. On qualifie aussi de vacherie le moindre objet récalcitrant ("Cette machine à expresso, c’est de la vacherie"), ou les actes qui nous défrisent ("Roger ne me fait que des vacheries"). Paradoxalement, le gentil bovidé nous sert aussi à exprimer notre admiration "La vache, quelles belles bottes !", ou notre horreur, "La vache, mes bottes neuves sont pleines de boue !"). Mais c’est l’adverbe vachement, devenu synonyme familier de très et de beaucoup depuis les années 1930, selon le Dictionnaire historique de la langue française, qui est la vraie légion d’honneur de la vache en français.
À noter, en revanche, que quand on dit "La ferme" pour faire taire quelqu’un, cela n’a rien à voir avec l’agriculture !