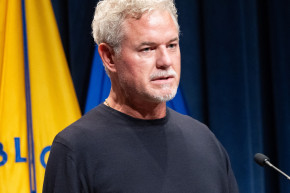En Direct
3 min de lecture
Langue française : faut-il écrire "faire bonne chère" ou "faire bonne chair"
Il y a des expressions que nous employons à tout bout de champ sans savoir les écrire, ni savoir ce qu’elles veulent dire !

Image d'illustration
Crédit : isaac-davis/unsplash
Amis des mots, je ne serais pas surprise de vous surprendre. C’est un beau gros livre que je viens de recevoir qui m’a donné l’idée de ce sujet. Il s’appelle Les Expressions françaises, quelle histoire !, publié par Le Robert. J’ai donc décidé d’en profiter pour vous parler d’expressions qu’on écrit de traviole, essentiellement parce qu’on ne sait plus ce qu’elles signifient.
Dans le genre, nous avions déjà évoqué "faire bonne chère", par exemple, qui signifie "faire un bon repas" mais qui s’écrit, rappelons-le, comme chère madame et non comme chair à saucisse. Ce qui semblerait plus logique, à première vue, je suis bien d’accord. Mais la chère de cette expression est une ancienne façon de nommer le visage. Le mot "cerveau est issu de la même racine", nous apprend le livre.
Au départ, faire bonne chère, c’était faire bon visage à celui que l’on reçoit et comme en France faire bon accueil est forcément synonyme de bien nourrir, le sens de l’expression s’est déplacé vers la table !
Acquit ou Acquis ?
Une autre expression dont l’orthographe surprend souvent : quand on fait quelque chose par acquit de conscience, c’est avec un T, comme dans le verbe acquitter, et non un S, comme dans la conjugaison du verbe acquérir. "L’acquit était autrefois le paiement d’une dette, puis la reconnaissance de ce paiement", explique le Robert.
"Dans ce sens, le mot a été évincé par quittance, mais il s’emploie encore dans la formule pour acquit" (IT), qui signifie "paiement reçu". À ne pas confondre, attention, avec "il tient ceci ou cela pour acquis", synonyme de "le tenir pour indiscutable, pour prouvé", car là, c’est A.C.Q.U.I.S.
Il y a coin et coing
D’autres homophones que l’on confond souvent dans nos truculentes expressions familières. Ne mélangez pas le coin de ce qui est "frappé au coin du bon sens", c’est-à-dire "plein de bon sens" et le coing du durillon de comptoir qui est "bourré comme un coing". Au coin du bon sens, c’est COIN, tandis que bourré comme un coing, c’est COING.
Pourquoi ? Tout simplement ce n’est pas le même coin/g. Le premier, le coin du bon sens, ce n’est pas un angle. C’est un autre sens de coin, un objet bien concret, par exemple "l’outil que l’on enfonce dans (…) une bûche pour la fendre. Du temps où l’on battait la monnaie (on la battait vraiment, avec un marteau)", précisent les auteurs du livre. Le coin était un sceau métallique gravé (un seau SCEAU, celui du garde des sceaux, pas un seau à eau SEAU, encore moins SOT qui est un imbécile). D’ailleurs, pour l’anecdote, "c’est ce coin français qui a donné l’anglais coin", désignant les pièces de monnaie.
Quant au coing de celui qui est "bourré", celui-là, c’est le fruit jaune du cognassier (rappelons que cognassier n’est pas un gros mot, juste un arbre fruitier bien élevé qui produit des fruits dont on fait notamment des pâtes de fruits et une gelée que j’adore). C’est probablement de la couleur jaune du coing "que vient le lien avec l’alcool qui, en endommageant le foie, donne un teint cireux, jaunâtre. D’ailleurs, la cirrhose vient du grec kirros, qui signifie roux", précise notre savant bouquin.
D'où vient l'orthographe de coaltar dans "être dans le coaltar" ?
Une dernière expression, et j’espère que les amis des mots ne sont plus trop dans le coaltar à cette heure, car justement, je voudrais leur demander : comment écrivez-vous ce coaltar-là ? Être dans le coaltar, c’est être dans une sorte de demi-sommeil. Je le vois très souvent écrit avec un D final, ou comme ça se prononce : COLTAR.
Mais le coaltar ne s’écrit pas comme il se prononce, loin de là ! Si le français a donné à l’anglais sa pièce (coin) l’anglais a donné au français son coaltar, un mot anglais, formé de deux termes, coal (charbon) et tar (goudron), le coaltar, c’est une "matière noire et visqueuse [qui] servait à colmater la coque des bateaux". L’expression, fait remarquer le livre, "n’est pas sans nous en rappeler une autre, plus facile à écrire : être dans le cirage".
Le cirage, comme le coaltar, offre l’image d’une matière noire et collante dont il est difficile de se débarrasser. Vous voilà complètement sortis du coaltar, amis des mots !