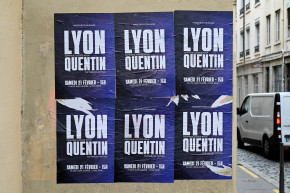3 min de lecture
Procrastination : comment faire pour arrêter de tout remettre au lendemain ?
La procrastination consiste à remettre au lendemain ce qu’on pourrait faire le jour même. On va voir comment se défaire de ce penchant qui ne fait pas vraiment du bien.

Une personne face à son clavier d'ordinateur (illustration)
Crédit : zan X JsI / Unsplash
Je m'abonne à la newsletter « Infos »
La procrastination désigne tendance à remettre au lendemain. Cela concerne beaucoup de monde ? "Je ne remets jamais au lendemain ce que je peux faire le surlendemain", disait Oscar Wilde. Eh bien oui, beaucoup de personnes pourraient le dire ! La procrastination est quelque chose de courant. Repousser le moment de prendre rendez-vous chez le médecin, de réviser des cours, de remplir des papiers, de reprendre le sport… 85% des Français disent que cela leur arrive.
Cette tendance à remettre à plus tard ce qu’on pourrait faire tout de suite n’a rien à voir avec de la paresse. La procrastination, ce n’est pas ne rien faire. Pour éviter une tâche, on est même parfois prêt à faire n’importe quoi d’autre, comme se lancer dans un grand ménage.
Et ça ne va pas de pair avec un état d’esprit forcément agréable. Les personnes qui procrastinent, de manière assez chronique, ont bien conscience que repousser leurs tâches n’est pas une bonne idée et que cela peut avoir des conséquences négatives.
Cela peut entraîner du stress inutile, un sentiment de culpabilité, parfois aussi une mauvaise estime de soi. Si dans l’immédiat, repousser une tâche procure un soulagement, ensuite, cela peut avoir des conséquences négatives, sur sa santé, son travail, ses relations avec les autres.
Considérer l'aspect positif des tâches
Alors, comment fait-on pour se débarrasser de cette mauvaise habitude ? Il ne suffit pas de se dire qu’on va arrêter de procrastiner, ni de penser qu’il s’agit juste de mieux gérer son emploi du temps. Les raisons de procrastiner sont plus psychologiques qu’organisationnelles. C’est pour cela que les tentatives de supprimer toute distraction, notamment numérique, sont souvent vaines.
Il s’agit avant tout de trouver la motivation pour passer à l’action. La psychologue Shékina Rochat, maître de conférence à l’université de Lausanne et auteure d’un livre sur la procrastination (Vaincre la procrastination, éd. Mardaga), estime que pour contrer cette fâcheuse tendance à reporter des tâches ternes ou contraignantes, il faut les transformer en activités plus intéressantes ou pleines de sens.
Concrètement, il faut parvenir à rendre motivant quelque chose de rébarbatif. Par exemple, on essaie de recadrer la tâche en considérant un aspect positif de celle-ci. La psychologue m’a raconté qu’une assistante en ressources humaines a réussi à retrouver du plaisir à s’occuper des fiches de paie de ses collaborateurs en imaginant ce qu’ils faisaient avec leur salaire.
On peut aussi ajouter du jeu ou du défi dans ses tâches, par exemple, plier son linge de façon originale en regardant des tutos, transformer son ménage en course contre la montre, en se fixant tant de minutes par pièce. On pense également au bénéfice : par exemple, vous n’aurez pas de pénalités si vous remplissez à temps votre déclaration d’impôts. En marchant après votre travail, vous allez vous vider la tête, évacuer les tensions, et vous sentir moins fatigué.
Éviter de culpabiliser
Et si on a quand même du mal à passer à l’action ? Eh bien, pour une tâche qui n’a pas, comme un examen, une véritable échéance, fixer une échéance arbitraire est souvent inefficace. Il est préférable de déterminer un moment précis où on va l’effectuer. Par exemple, vous planifiez de vous occuper de vos papiers ou de faire vos courses que le samedi matin.
Si vraiment, rien ne marche, c’est peut-être le signe que ce n’est vraiment pas le bon moment ou la bonne action à entreprendre. Et si on n’arrive pas à téléphoner ou à voir à une personne, on peut aussi s’interroger sur la relation que l’on entretient avec elle.
En tout cas, on évite de culpabiliser et on essaie de se pardonner d’avoir procrastiné. Plusieurs études ont montré que plus on se traite avec gentillesse, plus cela soutient la motivation, favorise l’optimisme et l’initiative personnelle.