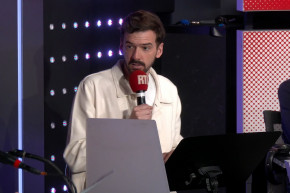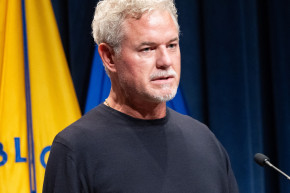- 03m04s
2 min de lecture
Sommes-nous vraiment le 1er janvier ?
Nous fêtons aujourd’hui le début de la nouvelle année… mais c’est une date toute relative, nous rappelle Muriel Gilbert.

Image d'illustration
Crédit : behnam-norouzi/unsplash
Amis des mots, vous croyez naïvement que nous sommes le 1er janvier 2023, je parie… Mais les calendriers ne sont pas gravés dans le marbre. Ils relèvent de décisions humaines. Pour le calendrier traditionnel chinois, par exemple, la nouvelle année ne commencera que le 23 janvier. Ah, et ce ne sera pas l’année 2023 mais l’année 4721 – ou 4720, les spécialistes du calendrier chinois ne sont pas d’accord entre eux !
Mais sans aller jusqu’à l’autre côté du globe, figurez-vous que, pour l’ancien calendrier romain, l’ancêtre de notre calendrier actuel, le jour de l’An était le 1er mars, et d’ailleurs l’année ne comptait que dix mois, janvier et février n’ayant été ajoutés que plus tard. Et plus près de nous encore... tenez, au lieu d’être bêtement dimanche 1er janvier 2023, nous pourrions très bien être duodi 12 nivôse 231.
Duodi 12 nivôse 231
Le premier de l’An, sous la Révolution, a été fixé au 22 septembre 1792, jour de la proclamation de la République, qui est ainsi illico devenu le 1er vendémiaire an I, les révolutionnaires ayant décidé de revoir de fond en comble le calendrier grégorien, qui leur semblait à la fois vieillot, peu rationnel et surtout beaucoup trop religieux. Et donc aujourd’hui, selon le calendrier révolutionnaire, nous serions le duodi 12 nivôse. Les mois duraient tous trente jours ; au lieu de semaines, ils étaient composés de trois décades de dix jours chacune, les noms des jours n’étant plus lundi, mardi, mercredi… mais primedi (pour le premier jour), duodi (pour le deuxième), tridi (pour le troisième), quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi (pour le dixième).
Les noms des mois, au contraire de ceux des jours, étaient extrêmement poétiques, d’ailleurs ils avaient été décidés par Fabre d’Eglantine, poète destiné à finir sur la guillotine, selon la sale manie de l’époque. Les noms des mois étaient censés dépeindre les différentes saisons. Nivôse, c’est le mois de la neige, il est suivi de pluviôse (celui des pluies), ventôse (celui des vents), ce sont les trois mois d’hiver. Au printemps viennent germinal (mois de la germination), floréal (les fleurs !), prairial, puis l’été avec messidor (période des moissons), thermidor (celle de la chaleur), fructidor (celle des fruits), et les vendémiaire, brumaire et frimaire qui parlent si bien d’automne. Joli, non ?
Et c’est Napoléon qui a mis fin à toute cette poésie… Au bout de treize ans seulement, l’Empereur a aboli le calendrier républicain – auquel en réalité les Français ne s’étaient jamais vraiment habitués. Le calendrier grégorien a repris son cours le 1er janvier 1806. Et donc, si nous sommes aujourd’hui le 1er janvier 2023, c’est en partie grâce à (ou à cause de) Napoléon !