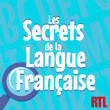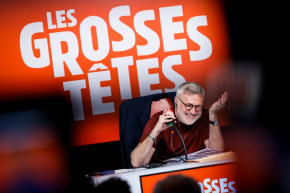- 02m47s
2 min de lecture
Pourquoi parle-t-on de macédoine de légumes ?
Quel est le point commun entre le bagne, l’eau de Javel, le corbillard et la macédoine ? Leur origine est étonnante.

Image d'illustration
Crédit : jacopo-maia/unsplash
Ce dimanche, j’ai plongé dans ma malle à histoire des mots, avec notamment un petit bouquin malin intitulé Les Mots aux origines étonnantes (chez First) grâce auquel je connais enfin l’origine du nom de cette spécialité des cantines de notre enfance, j’ai nommé la macédoine (je détestais ça).
J’avais bien repéré l’origine géographique du mot : cette région de la péninsule des Balkans, partagée aujourd’hui entre république de Macédoine, Bulgarie et Grèce. J’imaginais que ce mélange de petits morceaux était une spécialité locale. Que nenni, explique Sylvie Brunet, l’autrice du livre : ce plat a été nommé macédoine au XVIIIe siècle, parce qu’il était aussi composite que la région de Macédoine, qui a toujours été une mosaïque de peuples.
Nous avons déjà souvent évoqué dans le Bonbon sur la langue des noms communs issus de noms de lieux. Tenez, tout près des studios de RTL, à Paris, le village de Javel, aujourd’hui devenu un quartier du XVe arrondissement, a donné son nom au détergent, la javel, qui y était fabriqué à la fin du XVIIIe siècle.
Corbeil a donné le corbillard, Venise le ghetto
Toujours en région parisienne, la ville de Corbeil a donné son nom, devinez à quoi, amis des mots : pas à la corbeille de fleurs, non. Mais on n’est pas très loin de la couronne de fleurs, en tout cas, car Corbeil est à l’origine du nom du corbillard. On appelait ainsi le bateau qui transportait au XVIe siècle les passagers entre Corbeil et Paris. "Puis, raconte l’autrice, le mot fut appliqué à un grand carrosse, et à la fin du XVIIIe siècle, peut-être par dérision, au véhicule transportant les morts".
Pour rester dans un vocabulaire sombre, le ghetto, qui désigne ces quartiers où les juifs étaient forcés de résider, et aujourd’hui tout lieu où une communauté vit à l’écart, fut d’abord le nom d’une petite île de la si belle Venise. Cette île abritait une fonderie (getto en vénitien). Les juifs vénitiens furent relégués sur cette île à partir du XVIe siècle, rappelle Sylvie Brunet. À partir de là, le mot (...) eut le triste succès que l’on sait".
"C’est le bagne", "quelle galère"
Et tenez, puisque nous sommes dans les mauvais souvenirs, le bagne vient d’un mot beaucoup plus gai : le bain, bagno en italien. Mais comment le bain en est-il venu à désigner les travaux forcés ? Au XVIIe siècle, à Livourne, en Toscane, on a bâti sur le site d’anciens bains publics romains un pénitencier, qui a rapidement été surnommé bagno.
Les bagnes ont fait florès dans le monde entier, remplaçant progressivement la peine qui consistait à utiliser les condamnés comme rameurs sur les galères royales. Les derniers bagnards n’ont été libérés qu’au milieu du XXe siècle. Les expressions "quelle galère" et "c’est le bagne" sont d’ailleurs encore bien ancrées dans notre vocabulaire.
Et pour l’anecdote, quand on dit qu’on n’est "pas sorti de l’auberge", cette auberge est issue de l’argot des voleurs : elle désigne la prison, où l’on est gentiment nourri logé.