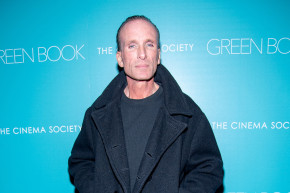En Direct
3 min de lecture
Orthographe : faut-il écrire "peu me chaud" ou "peu me chaut" ?
Muriel Gilbert nous alerte sur l’orthographe piégée de certaines expressions désuètes…
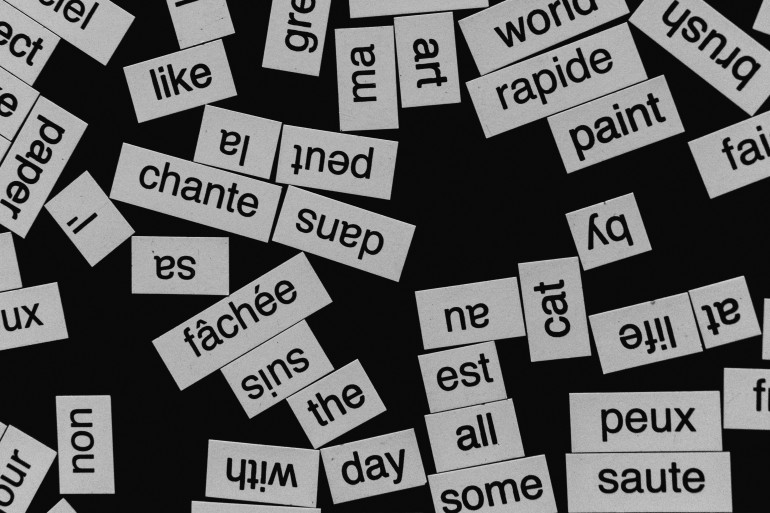
Image d'illustration
Crédit : aedrian-salazar/unsplash
Amis des mots, voici une expression un peu surannée peut-être, mais ultrachic, et qui génère quantité de fautes d’orthographe, parce qu’elle est basée sur un mot rare qui sonne comme un autre qui nous est familier.
Comment écrivez-vous la locution "peu me chaut/d" ? C’est-à-dire "ça m’est égal". On peut aussi dire "peu m’en chaut". C’est vrai que c’est une formule vieillotte, qu’on emploie aujourd’hui surtout par plaisanterie : "Valérie annonce un samedi pluvieux sur RTL ! – Peu me chaut, je prends l’avion pour les Antilles dans une heure".
Mais quel est ce drôle de chaut/d ? Pas le chaud du chauffage, bien sûr. D’ailleurs, il ne s’écrit pas CHAUD, comme celui de "j’ai trop chaud", mais CHAUT. Ce chaut est tout ce qu’il nous reste d’un verbe disparu depuis bien longtemps de notre langue : chaloir. Le dictionnaire de Furetière, qui date de 1690, le qualifie déjà de "vieux mot", c’est dire l’ancienneté de cette curiosité !
Le verbe chaloir
Chaloir est devenu ce qu’on appelle un verbe défectif, c'est-à-dire qui n’existe plus à tous les temps ou à toutes les personnes. Il se limite à une seule et unique forme : "il chaut", troisième personne du présent de l’indicatif, point final. Pratique à apprendre… Et donc le verbe, c’est chaloir, qui signifiait "importer" (importer, dans le sens de "ça compte", pas dans le sens de "Donald Trump ne veut plus importer de cognac"). Bref, "peu me chaut", c’est l’ancienne version de "peu m’importe".
Le plus rigolo, c’est qu’on pourrait considérer que ceux qui font l’erreur de l’écrire CHAUD ne sont pas si loin du compte… En effet, chaloir vient du verbe latin calere, signifiant à la fois "s’inquiéter" et… "être chaud". Et c’est vrai qu’on peut "bouillir d’inquiétude". Il nous reste aussi un adjectif de la famille de chaloir : nonchalant. Celui qui est nonchalant ne s’en fait pas… bref peu lui en chaut !
"Heur" ou "heurts" ?
Une autre expression chic et vieillie cause également bien des soucis à ceux qui l’emploient par écrit, c’est l’heur. Pas l’heure de "Il est neuf heures moins le quart sur RTL." Non, l’heur de "Je n’ai pas l’heur de vous connaître, chère madame", ou de "Il n’a pas eu l’heur de lui plaire".
Cet heur est masculin, contrairement à l’heure qu’il est, et il ne prend pas de E final. Il vient du latin augurium, signifiant "présage (favorable ou non)". C’est l’heur que l’on retrouve dans une série de mots joyeux : bonheur, heureux et heureusement. Et aussi dans un mot moins joyeux : malheur, on l’aime moins celui-là.
Il y a un autre heurt au masculin avec lequel il ne faut pas s’emmêler les pinceaux, c’est le heurt avec un T, du verbe heurter, qu’on utilise d’ailleurs le plus souvent au pluriel : "Les heurts entre la police et les manifestants".
Il y a une autre différence entre le heurt de heurter et l’heur du bonheur, c’est que le premier commence par un H aspiré, c’est pour cela qu’on dit le heurt, tandis que l’autre commence par un H muet, donc on dit l’heur.
Ce qui explique cette différence ? Les H à l’initiale des mots issus du latin sont muets en général : c’est comme s’ils n’étaient pas là, comme si le mot commençait par une voyelle ; tandis que les H issus des langues germaniques sont des H aspirés, qui ne permettent ni liaison ni élision. Heurter vient du francique, la langue des Francs, une langue germanique, voilà pourquoi “entre police et manifestants” on parle de heurts et non d’heurts.
Ce fut un bonheur de partager ces heur/ts avec vous, amis des mots, mais maintenant, sans vouloir vous heurter, il est l’heure de fermer le paquet de Bonbons sur la langue !