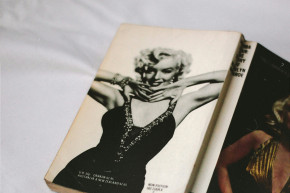En Direct
3 min de lecture
Langue française : quelle est l'origine du mot "Loto" ?
Les mots voyagent entre les langues, certains ont même traversé plusieurs fois les Alpes, s’amuse Muriel Gilbert…

Image d'illustration
Crédit : dylan-nolte/unsplash
Ce dimanche 11 mai, reprenons la balade autour du monde des mots, à la demande de quantité d’auditeurs, amusés par les chips, le chic et le pyjama de la semaine passée – j’avoue qu’ils n’ont pas eu besoin de me supplier beaucoup pour que je me penche à nouveau sur le livre de Sophie Dubois-Collet Ces 101 mots venus d’ailleurs (éditions de l’Opportun). Et comme la douce époque de la déclaration d’impôts est revenue, nous allons commencer par parler du loto…
Vous ne voyez pas bien le rapport, peut-être ? Le rapport, c’est qu’"avant d’être un jeu, le lotto [avec deux T car on est en Italie, eh oui] fut d’abord un impôt extraordinaire institué en 1530, à Florence, pour renflouer les caisses de la ville". Une drôle de conception de l’équité avait donné l’idée de percevoir l’impôt au moyen d’un jeu de hasard : tu as tiré le mauvais numéro, tu paies.
Le concept de la loterie pour financer l’État sera repris par François Ier moins de dix ans plus tard, mais sans grand succès. Deux siècles après, Louis XVI fondera à son tour la Loterie royale, qui sera supprimée par les Républicains en 1793 au nom de la morale… avant de renaître sous le nom de Loterie nationale en 1933, au bénéfice, fort moral celui-là, des "gueules cassées", les poilus de la Première Guerre mondiale blessés au visage.
Et c’est Jacques Chirac, premier ministre, qui en 1975 instituera finalement le Loto (avec une majuscule) tel que nous le connaissons aujourd’hui… ou à peu près, cette fois avec l’objectif de combler le déficit de finances publiques mises à mal par le choc pétrolier de 1973.
On peut dire que, jusqu’à la privatisation récente de la Française des jeux, le Loto était une sorte d’impôt volontaire, youpi. Parallèlement à ces bonnes idées pour renflouer l’État, le loto (sans majuscule cette fois) s’était aussi imposé en tant que jeu de hasard où les joueurs doivent recouvrir un petit carton avec les numéros tirés d’un sac.
Du lot, au lotto, puis au loto
Le mot vient donc de l’italien, et il sonne bien italien. Le Dictionnaire historique de la langue française le trouve "pour la première fois en 1782 dans un texte qui range ce jeu parmi les divertissements à la mode". Ce qui est amusant, c’est que le mot italien lotto, avec deux T donc, qui désigne à l’origine "le sort, le hasard", est un emprunt au français lot. En somme, le français lot a donné l’italien lotto avec deux T qui a donné le français loto avec un seul T ! Une fois de plus les idées et les mots voyagent… ils font même des allers-retours !
Si vous avez (vraiment) beaucoup de chance et que vous avez gagné au Loto, amis des mots, vous irez demander votre gain au guichet de la Française des jeux, guichet qui nous a donné un autre délicieux mot venu d’ailleurs. "Autrefois, raconte Sophie Dubois-Collet, les portes des maisons allemandes avaient une petite ouverture appelée ‘guichet’. Lorsqu’un visiteur toquait, le propriétaire demandait : ‘Was ist das ?’" Ce qui se traduit par "Qu’est-ce que c’est ?", comme vous le savez si (pas comme moi) vous avez fait de l’allemand au collège. Les trois mots allemands, mal compris par les Français, sont arrivés chez nous coagulés en un seul mot, vasistas, comme ça se prononce, pour désigner d’abord un guichet, puis une fenêtre de petite taille.
Un dernier mot venu d’ailleurs, pour terminer ? Je vous propose qu’on parle du jean. Ce vêtement résistant qui a colonisé le monde entier depuis l’Amérique vient en fait d’un peu partout en Europe. D’abord, jean est une déformation du nom de la ville de Gênes, en Italie, où l’on fabriquait, dès le XVe siècle, une toile hypersolide destinée aux vêtements des marins. Cette toile, de couleur écrue, était ensuite "teinte en bleu en France, à Nîmes", d’où lui vient le nom de denim.
Et, au XIXe siècle, c’est un Allemand installé aux États-Unis, un certain Levi Strauss, qui taille les premiers blue-jeans. Les chercheurs d’or seront les premiers à les adopter, puis les ouvriers du pays, puis la jeunesse hippie et rock des années 1950 et 60, puis finalement le monde entier. Qui porte un jean, ce matin ?
- Orthographe : faut-il écrire "un gilet sans manche ou "un gilet sans manches" ?
- Orthographe : faut-il écrire "prendre parti/e" ou "prendre à parti/e" ?
- Langue française : faut-il écrire "Je vous serais gré ?" ou "Je vous saurais gré ?"
- Langue française : quelle est la différence entre "docteur" et "médecin" ?