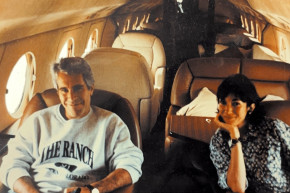4 min de lecture
Méga-bassines : 4 questions pour comprendre ce projet controversé
Entre 7.000 et 10.000 manifestants sont attendus à Sainte-Soline près de Niort dans les Deux-Sèvres aujourd'hui et tout le week-end pour protester contre un projet de "méga-bassines". RTL vous explique à quoi elles ressemblent et pourquoi elles suscitent tant de controverses.

Des militants manifestent contre de méga-bassines à Mauze-sur-le-Mignon, le novembre 2021
Crédit : XAVIER LEOTY / AFP
Je m'abonne à la newsletter « Politique »
Une nouvelle manifestation contre les méga-bassines des Deux-Sèvres doit se tenir samedi 25 mars et dimanche. Plus de 3.000 forces de l'ordre mobilisées d'un côté, 1.500 "activistes violents" attendus de l'autre : cette nouvelle manifestation contre les "bassines", symbole des tensions autour de l'accès à l'eau, est placée sous haute sécurité ce samedi. Voici 4 questions pour tout comprendre au projet.
1. Qu'est-ce qu'une méga-bassines ?
Ces méga-bassines sont des réserves d'eau que les agriculteurs veulent construire pour pouvoir continuer à cultiver malgré les sécheresses. Le projet qui prévoit la construction de 16 bassines, évoque près de 6 millions de mètres cube, ce qui correspond à peu près 1.500 piscines Olympiques. En France, il y a 130 méga-bassines qui ont déjà été construites, surtout en Poitou-Charentes qui est une région agricole avec de plus en plus de sécheresse et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où il y a besoin d'alimenter les canons à neige l'hiver. Dans les Deux-Sèvres, les agriculteurs disent qu'il leur faudra de l'eau et des bassines, sous peine de ne pas pouvoir alimenter la population.
2. Qui sont les opposants au projet ?
Ces bassines sont posées dans les champs et dépassent dans le paysage comme d'immenses piscines hors sol. Le fond de la bassine est recouvert de bâches étanches pour retenir l'eau pompée dans le sous-sol. Ce sont d'ailleurs ces bâches qui sont lacérées lors des manifestations. Cette eau doit permettre aux agriculteurs d'irriguer les champs l'été. Parmi les opposants, il y a des agriculteurs de la confédération paysanne, qui craignent que leurs collègues accaparent l'eau des exploitations dans le but de faire des réserves pour l'hiver. Ils craignent que ça perturbe les nappes et que tous les petits paysans autour qui ont des forages auront encore moins d'eau que d'habitude l'été.
Un projet décrié pour plusieurs raisons
3. Pourquoi le projet est-il critiqué ?
Pour les agriculteurs pointés du doigt, c'est une question de survie. S'ils n'ont pas assez d'eau, ils ne pourront pas maintenir leur ferme familiale. "Les sécheresses sont récurrentes, on est sur un territoire ou l'eau passe l'hiver avec des nappes qui sont malheureusement pour nous superficielles donc fragiles. En fait, l'eau de pluie transite dans ces nappes et ressort par les exutoires", explique Thierry Boudaud le président de la coopérative de l'eau. "Donc, on a de l'eau qui passe, on peut en stocker une petite partie intelligemment en la prenant l'hiver avec les retenues d'eau. Il ne s'agit d'aller prendre de l'eau dans les nappes en profondeur pour la mettre en extérieur, mais il s'agit de capter une partie de l'eau qui transite sur le territoire avant qu'elle parte à la mer", poursuit-il.
Ces arguments sèment le doute chez les hydrologues parce que le trop-plein des nappes va se perdre dans la mer, mais avant d'arriver à la mer, l'eau sur son chemin sert à alimenter les rivières. Une rivière, c'est une nappe qui déborde donc il y a un risque d'assécher les cours d'eau et de déséquilibrer le cycle de l'eau. L'hydrologue Emma Haziza a observé la carte des bassines qui existent déjà et a regardé où les préfets prenaient des restrictions d'eau. Il s'avère que là où il y a des bassines, les restrictions d'eau sont de plus en plus tôt dans l'année.
Un grand plan sur l'eau à venir
4. Comment faire des réserves ?
Alors, on peut faire des réserves, mais plutôt que de les remplir en pompant dans les nappes, on peut essayer de les remplir avec l'eau de pluie en faisant des barrages qui retiennent l'eau. Faire des réserves l'hiver, oui, disent les hydrologues, mais en changeant l'agriculture avec des céréales mieux adaptées à la sécheresse. Par exemple du sorgho plutôt que du maïs. Des techniques qui permettent de couvrir le sol pour le garder humide. Beaucoup d'agriculteurs le font déjà, ils vont devoir aller plus loin. Pour cela, ils ont besoin de moyens. Justement, Elisabeth Borne devait annoncer un grand plan sur l'eau pour les aider mardi dernier, le jour du 49.3.
À Sainte-Soline, le service central du renseignement territorial parle d'un rendez-vous à haut risque, car le dossier des méga-bassines devient un symbole qui attire des contestataires au-delà de nos frontières. Le dispositif de la gendarmerie nationale est massif, toute la zone est déjà sous surveillance avec fouille des véhicules et contrôle d'identité.
- Les infos de 12h30 - Méga-bassines : un jeu du chat et de la souris entre la police et les manifestants
- Réforme des retraites : Macron se dit "à disposition de l'intersyndicale", après le Conseil Constitutionnel
- Charles III en France : Macron estime "pas sérieux de proposer une visite d'État au milieu des manifestations"
- Manifestations et violences : l'inquiétude gagne le gouvernement