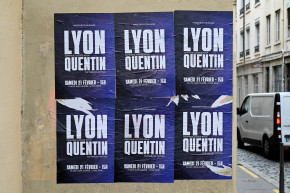- 01m56s
3 min de lecture
Don d'organes : comment fonctionne cette démarche ?
ÉCLAIRAGE - Selon un rapport de l'Agence de la Biomédecine, le nombre de greffes a progressé. En 2015, plus de 15 greffes par jour ont été effectuées.

Don d'organes : comment fonctionne cette démarche ?
Crédit : Brendan Smialowski - AFP
Je m'abonne à la newsletter « Infos »
Le don d'organe peut aider à sauver des vies mais aussi permettre des avancées scientifiques grâce à la donation de son corps à la science. Il est parfois difficile de comprendre le fonctionnement et les étapes à suivre. Le procédé le plus connu et utilisé est la greffe d'organe.
Selon des chiffres de l'Agence de la Biomédecine, une agence relevant du ministère de la Santé, le nombre de greffes a encore progressé l'an dernier pour atteindre plus de 15 par jour et la liste d'attente continue de s'allonger. Les Français sont de plus en plus nombreux à faire don de leurs organes. Bien que cette hausse soit une bonne nouvelle, elle ne suffit pas, face au nombre croissant de patients en attente d'organes.
Dans quel cas la greffe d'organe est-elle envisagée ?
La greffe d'organe, aussi appelée transplantation, sert à renouveler un organe, qu'une maladie a rendu hors service. On peut notamment rencontrer des personnes atteintes de malformation cardiaque, de mucoviscidose, d'insuffisance rénale terminale voire même de certains cancers. Néanmoins, chaque maladie représente une greffe bien précise. Il y a quatre greffes : la greffe cardiaque, la greffe pulmonaire, la greffe du foie et la greffe rénale, explique le site spécialisé des dons d'organes du ministère de la Santé.
Cette décision est loin d'être bénigne et les médecins les prennent au cas par cas. Le plus souvent, la greffe d'organe dépend de l'évolution de la maladie, de l'efficacité des traitements prescrits ainsi que l'état de santé du patient. Le remplacement d'un organe est véritablement le dernier recours. Si la greffe est effectuée, c'est qu'elle est devenue vitale pour le malade. Une fois la greffe validée, le don d'organes suit des étapes précises afin d'éviter le moindre problème, comme le montre le site de l'Agence de la Biomédecine.
Comment devenir donneur d'organe ?
Pour qu'une transplantation ait lieu, il faut qu'un donneur se manifeste. Tout d'abord, le site du gouvernement explique que tout sujet en état de mort encéphalique (cérébrale), en dépit des efforts des médecins pour le sauver, peut et doit être considéré comme un potentiel donneur. Pour cela, il est précisé q'une série d'examens est effectuée telle que des recherches d'antécédents médicaux ainsi qu'un dépistage d'éventuelles maladies transmissibles. Malheureusement, les circonstances de décès favorables au prélèvement sont rares.
Il faut signaler à ses proches sa volonté d'être donneur afin que ces derniers puissent témoigner. La personne peut également créer une carte de donneur d'organes, qu'il faut porter sur soi. Selon le site officiel de l'administration française, elle n'est pas obligatoire mais facilite le bon déroulement du processus et permet d'affirmer sa position auprès de ses parents dont l'accord est de rigueur. Pour l'obtenir, il suffit de s'adresser à l'Agence de la Biomédecine ou à des associations. Enfin, il n'y a pas d'âge minimum, incluant donc les mineurs à la liste.
Je refuse de donner mes organes
Il peut arriver qu'une personne ne souhaite pas donner ses organes. Dans ce cas, il est recommandé de s'inscrire sur le Registre National des Refus, auprès de l'Agence de la biomédecine. Cette personne aura donc l'assurance qu'aucun prélèvement ne sera effectué le jour du décès. Néanmoins, le site spécialisé de l'agence précise que la manière la plus efficace reste la communication avec les proches, vers qui se tourneront les équipes médicales.
À ne pas confondre avec le don du corps à la science
Le don du corps est une démarche personnelle et volontaire à des fins d'enseignement et de recherche. Le site de l'administration française indique que seule les personnes majeures peuvent faire don de leur corps. Pour cela, il est demandé d'adresser à la faculté de médecine de son choix une déclaration manuscrite afin de savoir si un centre de don est à disposition.
Lorsque la faculté de médecine reçoit cette déclaration, plusieurs documents sont réclamés : une fiche de renseignement complétée, une fiche de confirmation du don, la photocopie recto/verso d'une pièce d'identité ainsi qu'une enveloppe afin de recevoir sa carte de donneur. Contrairement à la greffe, le don du corps est une démarche payante dont les frais varient en fonction du centre de don.