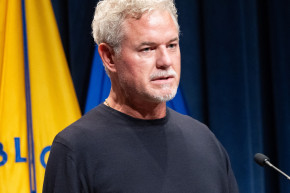- 30m20s
6 min de lecture
Les Français et le travail : congés payés, salaires, métiers en tension... Les 10 idées reçues décryptées par RTL
À l'approche du 1er mai, François Bayrou a critiqué les Français, jugeant qu'ils ne travaillaient pas assez. Jours de congés payés, salaires, métiers en tension... RTL décrypte les nombreuses idées reçues sur le monde du travail.

Une réunion de travail (illustration)
Crédit : RTL
Je m'abonne à la newsletter « Économie »
À l'occasion de son discours sur l'état des finances publiques, le mardi 15 avril, le Premier ministre François Bayrou a affirmé que les Français ne "travaillent pas assez". "La politique de retour de la production et de réindustrialisation [...] doit devenir une obsession pour notre nation", a-t-il assuré, appelant les Français à "une prise de conscience [pour] soutenir une action déterminée".
Évoquant une "heure de vérité", il a espéré que "la confrontation les yeux ouverts avec la vérité de notre situation" puisse permettre au gouvernement d'obtenir le "soutien" des Français.
François Bayrou a également constaté un "manque de ressources", et a souligné "le faible taux d'emploi des jeunes et des seniors". Ce lundi, RTL met le travail à l'honneur et décrypte 10 grandes idées reçues.
1. Les Français travaillent-ils moins et sont-ils moins productifs ?
Selon les chiffres d'Eurostat et de Rexecode sur les dix dernières années, la France se situe avant-dernière en termes de temps de travail. Seule la Finlande travaille moins. À temps plein, un employé français va travailler 1.673 heures par an, soit 113 heures de moins que la moyenne européenne (1.790 heures, le niveau de l'Allemagne). Le record d'Europe est détenu par la Roumanie, qui travaille quelque 2.000 heures par an.
Plusieurs changements expliquent ce classement. Depuis 1981, on a réduit le temps de travail hebdomadaire (de 40 à 39 heures), le temps de travail annuel (cinq semaines de congés payés au lieu de quatre) et le temps de travail sur toute la vie (passage de l'âge à la retraite de 65 à 60 ans). En réalité, on travaille 350 heures de moins qu'en 1975.
Cependant, les Français sont plus productifs sur la moyenne européenne, selon le calcul réalisé par Rexecode, qui ne prend en compte que les salariés à temps plein, soit un salarié sur deux.
Mais si on ajoute le temps de travail des employés en temps partiels et celui des indépendants (professions libérales ou auto-entrepreneurs), la France rattrape ses voisins. Car ce sont ceux qui ont les emplois les moins sécurisés qui travaillent le plus.
2. Les Français sont-ils mieux payés ?
En France, le salaire horaire brut médian s'élève à 16,50 euros, plaçant le pays à la 10e place européenne (sur 27), derrière l'Allemagne (18,90 euros) ou le Luxembourg (23,80 euros). Au Danemark, les employés sont même payés près de 30 euros de l'heure. En Hongrie ou en Roumanie, le salaire horaire brut médian est d'environ 5 euros.
La différence avec d'autres pays, c'est que la France compte une main-d'œuvre peu qualifiée qui est calée sur le SMIC. Et cette main-d'œuvre, elle est chère par rapport à nos concurrents. Nous sommes dans les six pays d'Europe où le salaire minimum est le plus élevé, avec 1.801 euros brut mensuel, soit 1.426 net. Un SMIC élevé qui sert à justifier la désindustrialisation et le choix de mettre des machines plutôt que des hommes en France.
3. Les Français ont-ils plus de congés payés ?
Non, la France, avec ses 36 jours non-travaillés (25 jours de congés payés et 11 jours fériés), ne compte pas plus de jours de repos que ses voisins. L'Espagne et la Suède en comptent autant. Il y en a même 38 en Autriche, 41 à Malte. En revanche, l'Allemagne ne compte que 33 jours de congés payés, le Portugal 34, l'Italie 31 et la Belgique 30.
4. Les jeunes travaillent-ils moins et sont-ils plus absents ?
Il est vrai que les jeunes travaillent moins que d'autres catégories de la population active, mais c'est contre leur gré. Ce n'est pas par flemme. En réalité, les chiffres de chômage des jeunes de moins de 24 ans étaient, en 2024, de 19% (la moyenne européenne est de 14,5%). La France a donc moins de jeunes au travail que ses voisins.
Il y a, premièrement, un certain nombre de jeunes qui terminent leurs études tardivement, entrent donc tard sur le marché du travail et commencent par des petits boulots. Deuxièmement, plus d'un jeune de 15 à 24 ans sur huit n'a ni travail, ni études, ni formations, selon le cercle des économistes.
L'absentéisme des jeunes est, en réalité, très faible : il s'établit à 1,77% pour les moins de 30 ans, selon le dernier baromètre de l'absentéisme Ayming-AG2R La Mondiale. C'est moins que les plus de 55 ans, qui sont souvent victimes d'usures professionnelles.
Toutefois, il faut faire preuve de prudence, car depuis le Covid, il y a une montée des absences de plus de trois mois pour des raisons psychologiques. C'est en hausse de 30% depuis 2019 et c'est essentiellement les jeunes qui sont concernés, ces derniers ayant besoin de repos à cause d'une pression psychologique.
5. Les patrons ont-il du mal à recruter ?
C'est vrai, puisqu'un employeur sur deux ne trouve pas l'employé qu'il recherche, selon la dernière enquête de Besoin de Main-d'œuvre (BMO) de France travail. Mais c'était pire l'année dernière, avec 57,3% des patrons qui n'arrivaient pas à trouver un salarié.
Les raisons sont multiples : ils reçoivent des CV qui ne correspondent pas au poste, ils ne reçoivent pas de candidatures du tout ou les postes proposés ne sont pas attractifs, mal payés, pénibles ou mal considérés.
Mais s'ils ont un peu moins de mal à recruter cette année, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, car les patrons ont moins l'intention d'embaucher : les intentions d'embauche sont en chute de 12,5% par rapport à l'année dernière, donc cela engendrera une remontée du chômage.
6. La France pourrait-elle s'en sortir sans l'immigration ?
Faux. La liste des métiers en tension est la même depuis plusieurs années : tous les métiers de l'hôtellerie-restauration (plus de 200.000 personnes recherchées), les agriculteurs, les agents d'entretien, les aides à domicile, auxiliaires de vie ou aides-soignants (plus de 120.000 postes non pourvus). Mais cela concerne également des métiers techniques : on cherche 150.000 ingénieurs en cyber sécurité et ces postes n'existent pas pour l'instant.
Selon le baromètre BMO, il y a 2.430.000 postes à pourvoir en France cette année et on estime que plus de 300.000 postes d'agents d'entretien pourraient ne pas être pourvus cette année.
De nombreux secteurs ont donc recours à de la main-d'œuvre étrangère : construction, restauration, soins, ménages, soit des métiers en tension depuis des années et considérés comme essentiels au moment de la pandémie. Ce sont des métiers difficiles, parfois à temps partiel, saisonniers, assez mal payés, avec une concurrence du travail au noir. Résultat, il y a peu de candidats nationaux. Sans l'immigration, on ne pourrait donc pas avoir la flexibilité nécessaire.
7. Va-t-il falloir travailler plus tard ?
En réalité, la raison pour laquelle le marché du travail est bouleversé est la conséquence de quatre chocs simultanés. Il est plus important de déterminer comment les Français vont travailler demain avant de se demander s'ils ne travaillent, réellement, pas assez.
Il y a, premièrement, un choc démographique, car en 2030, un actif sur cinq aura plus de 55 ans et la population des 75-84 ans aura augmenté de 50 % sur les dix dernières années. Il y aura donc bientôt plus de seniors que de jeunes, signifiant que la carrière de ceux qui travaillent va s'étirer. Et c'est sur les fins de carrière que ces changements auront lieu, car il y aura moins de nouveaux entrants sur le marché du travail, donc il va falloir impliquer davantage les quinquagénaires et les sexagénaires.
Actuellement, seuls 12% des plus de 50 ans bénéficient de formation, c'est beaucoup moins que les autres tranches d'âge. Il faudra également se pencher sur l'orientation des jeunes vers les métiers du grand âge, qui sont aujourd'hui en pénurie.
8. L'IA va-t-elle bouleverser le marché du travail ?
Le deuxième choc est technologique, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle : 70% des métiers actuels seront chamboulés par l'IA, qui va dégager du temps en faisant plus vite que nous certaines tâches. Mais que faire de ce temps libéré : réduire les effectifs ou améliorer certaines tâches ? Cela pose également la question de la sécurité des informations : la France recherche déjà 15.000 ingénieurs en cyber sécurité, impossibles à trouver car ils n'existent pas.
9. Le dérèglement climatique va-t-il impacter l'ensemble des travailleurs ?
Vient ensuite le choc écologique. Il y avait les cols bleus (ouvriers) et les cols blancs (dans les bureaux). Il y aura bientôt, les cols secs et les cols mouillés, soit ceux qui souffrent du réchauffement climatique, ou pas. Cela ne concerne pas uniquement les ouvriers du bâtiment, mais aussi ceux qui télétravaillent et n'ont pas la climatisation chez eux. Mais le climat est aussi un réservoir de métiers de demain : conseillère en rénovation énergétique, architecte en éco-construction, ingénieur process bas-carbone, juriste en environnement...
10. Le travail a-t-il perdu de son sens ?
Enfin, le dernier choc est le choc éthique. Une quête de sens très présente chez les jeunes générations, avec cette question : à quoi sert vraiment mon emploi ? Le Covid a rebattu les cartes et cette quête de sens est devenue centrale dans les choix des salariés. Dans les années 1990, les jeunes étaient 60% à accorder une place prépondérante au travail, aujourd’hui ils sont trois fois moins. Conséquence, les jeunes ne veulent plus de CDI pour garder leur liberté. Cela dessine une nouvelle relation vis-à-vis de l'employeur.
- CDD de reconversion : comment fonctionne ce nouveau contrat pour expérimenter sans risque
- Pourquoi obtenir une rupture conventionnelle est devenu plus difficile depuis le 1er janvier 2026
- INFO RTL - Offres d’emploi en baisse, CDI plus rares : le ralentissement du marché du travail se confirme, les jeunes en première ligne