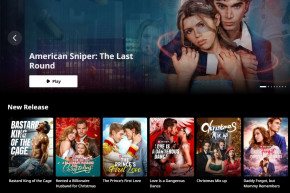En Direct
15 min de lecture
Bac 2024 : découvrez les sujets et corrigés de l'épreuve de français
Les élèves de première générale et technologique ont passé, vendredi 14 juin, leur épreuve écrite anticipée de français. Découvrez les corrigés de l'épreuve.

Des copies du baccalauréat dans une salle d'épreuve (illustration)
Crédit : MARTIN BUREAU / AFP
Je m'abonne à la newsletter « Infos »
C’est aujourd’hui, le vendredi 14 juin 2024, que les candidats ont découvert et réaliser l’épreuve anticipée de français du baccalauréat. Quelles sont les œuvres du programme présentes dans l’examen ? Pour connaître la composition de l’épreuve anticipée de français au bac, consultez les sujets officiels délivrés par l’agence de presse de l’Éducation nationale, et leur corrigé réalisé par des professeurs certifiés.
L’épreuve écrite de français est la première étape dans l’obtention du diplôme du baccalauréat ! Première grande épreuve sur table, elle peut s’avérer intimidante. D’un coefficient 5, et d’une durée de 4 heures, l’écrit de français est composé : d’un commentaire de texte et de trois sujets de dissertation, en voie générale ; d’un commentaire de texte et de trois contractions de texte à effectuer suivies chacune d’un essai à réaliser, en voie technologique. Les élèves doivent choisir l’un des sujets à traiter, au choix.
Une correction inédite et officielle de chaque sujet est fournie par des professeurs de l’Éducation nationale. Découvrez-les afin de connaître les attentes durant cet examen ! Est-ce que la méthodologie et les pistes d’analyse exploitées étaient les bonnes ? N’attendez plus, et retrouvez les sujets corrigés complets du bac de français 2024, pour les filières générale et technologique.
Sujet et corrigé du bac de français de première générale
Cette année, le sujet du bac général de français 2024 se concentre sur les objets d’étude "Le roman et le récit du Moyen Age au XXIe siècle" pour le commentaire, et "La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle" pour les trois dissertations dont les œuvres au programme sollicitées sont : le recueil de poèmes Cahier de Douai d’Arthur Rimbaud comprenant de Première soirée à Ma Bohème (Fantaisie) du parcours "émancipations créatrices" ; La rage de l’expression de Francis Ponge du parcours "dans l’atelier du poète" ; et, pour finir, Mes forêts d’Hélène Dorion du parcours "la poésie, la nature, l’intime".
Sujet officiel de l’épreuve de français 2024 en voie générale
On peut retrouver la composition détaillée suivante :
- Un commentaire de texte extrait de l’œuvre Édouard de Claire de Duras (1825).
- Un sujet de dissertation sur le Cahier de Douai de Rimbaud dont le sujet est : "Dans le poème "Sensation", Arthur Rimbaud écrit : "j’irai loin, bien loin". Selon vous, le Cahier de Douai répond-il à ce projet ?".
- Une dissertation à composer à propos de La rage de l’expression de Ponge et dont le sujet est : "Selon un critique, La rage de l’expression donne à voir "l’écriture en plein travail et se regardant travailler". Cette citation éclaire-t-elle votre lecture de l’œuvre ?"
- Un sujet de dissertation sur Mes forêts d’Hélène Dorion avec, pour sujet : "Dans Mes forêts, Hélène Dorion écrit : "mes forêts, racontent une histoire". En quoi cette citation éclaire-t-elle votre lecture de l’œuvre ?"
Correction de l’épreuve de français 2024 du bac général
Commentaire de texte - Édouard de Claire de Duras (1825)
Thème à traiter : Amour impossible, passion amoureuse, paysage-état d’âme, normes sociales, rang social, conflit devoir/sentiments
Analyse du sujet : Le texte met en scène le dépit d’un jeune homme amoureux d’une jeune duchesse alors qu’il est lui-même roturier.
Enjeu du sujet : Montrer comment le héros est guidé par la passion et l’honneur.
Problématique : En quoi cet extrait est-il un texte romantique ?
Un plan possible :
I. Un texte romantique
A) La nature en écho aux sentiments du personnage
Idée : La description d’un soir d’été semble être un paysage-état d’âme digne des grands écrivains romantiques
Argument : La beauté du soir d’été renforce la beauté de la femme aimée et par la même occasion la passion du personnage.
Exemples : Tous les sens sont sollicités dans le spectacle de la nature. Avec la vue : "je voyais" ; l’odorat : "grand jasmin", "parfum du jasmin" ; le toucher : "air frais". Le narrateur-personnage est enivré par les parfums de la nature et les confond avec ceux de Mme de Nevers : "[...] et ce souffle embaumé semblait s’exhaler de celle qui m’était si chère !" La confusion des sens révèle ainsi la confusion du personnage éperdu d’amour.
La nature parle pour les personnages, ce qui singularise l’expression de leur amour comme dans le roman sensible du XVIIIe.
B) Souffle paisible de la nature et souffle vigoureux de l’amour
Idée : La chaleur de l’été et le souffle du vent sont la métaphore du souffle de l’amour qui agite le personnage.
Argument : L’opposition entre le calme environnant et l’agitation intérieure passionnée du jeune homme.
Exemples : le champ lexical de l’harmonie "paix", "silence", "harmonie" contraste avec les termes qui décrivent les sentiments d’Édouard : "enivrait" (radical = ivre), "avidité", "vive émotion", "s’empara". Ainsi, le jeune homme ne se contrôle pas car nous savons qu’un coup de foudre est à l'origine de son amour comme le montre l’adjectif "irresistible" l. 19
II. Une passion douloureuse car impossible
A) La force de l’amour est indicible
B) Un amour impossible
Sujet A - Cahier de Douai de Rimbaud dont le sujet est : "Dans le poème "Sensation", Arthur Rimbaud écrit : "j’irai loin, bien loin". Selon vous, le Cahier de Douai répond-il à ce projet ?"
Thème à traiter : liberté, émancipation physique et poétique
Analyse du sujet : le sujet se construit sur une répétition renforcée par le modalisateur "bien" ce qui crée une insistance sur la volonté de départ, la quête de liberté. Le verbe est au futur, qui est un temps de la certitude : ce départ "bien loin" aura lieu.
Enjeu du sujet : Montrer que la quête de liberté, notamment à travers le motif de la fugue, permet la création poétique : il s’agit de s’émanciper physiquement pour s’émanciper poétiquement et esthétiquement.
Problématique : Plus qu’un simple motif, en quoi la quête de liberté permet-elle à Rimbaud de s’émanciper poétiquement ?
Un plan possible :
I. Un poète en quête de liberté
A) Le motif récurrent de la fugue
B) Une quête de sensations
II. La fugue comme source d’inspiration
A) Une émancipation vis-à-vis des codes poétiques
B) Une émancipation de la pensée
III. Cet éloignement demeure néanmoins au statut de projet poétique
A) Les difficultés à briser complètement les liens
B) Un projet poétique dont les contours seront définis ensuite
Sujet C - Mes forêts d’Hélène Dorion avec, pour sujet : "Dans Mes forêts, Hélène Dorion écrit : "mes forêts, racontent une histoire". En quoi cette citation éclaire-t-elle votre lecture de l’œuvre ?"
Plan détaillé possible :
Thèmes à traiter : La poésie, la nature, l’intime
Analyse du sujet : La citation bouscule la séparation qui prétend opposer l’humanité au monde : le monde se fait l’écho de l'humain selon H. Dorion. Relever l’adjectif possessif "mes" qui répond à "une" (indéfini) : il ne s’agit pas seulement de l’histoire d'Hélène (peu de noms propres relient les poèmes à l’environnement de la poète) mais d’une histoire dans laquelle chacun peut se reconnaître.
Enjeu(x) du sujet : montrer qu’Hélène Dorion s’inscrit dans une longue tradition de la poésie qui parle de la Nature, des Bucoliques de Virgile, en passant aux Romantiques du XIXe siècle jusqu’à Jaccottet dans laquelle la nature est à l’image de l’Homme, dans laquelle extérieur et intérieur se répondent.
Problématique : comment la poésie parle-t-elle de la nature, c'est-à dire de l’extérieur, et dans le même temps de l’intérieur, de l’intime de l’Homme ?
I. La structure même du livre comme narration
A) Hélène Dorion récuse le terme "recueil"
Idée : Mes forêts ne rassemble pas des poèmes épars, mais raconte une histoire, celle d’Hélène et des autres (nous).
Argument(s) : L’étude des titres du sommaire montre un mouvement construit.
Exemple(s) : Lire seulement un ou deux poèmes est impossible, à l’instar d’une pièce de théâtre ou d’un roman, qui se lisent dans leur intégralité : "Mes forêts, dit-elle, devrait être lu en entier, du début à la fin parce que son architecture construit un parcours, un itinéraire. Mes Forêts s’apparenterait presque à un roman, dans le sens où ce livre raconte une histoire, qui part d’un début et qui va vers une fin."
B) Un livre sur la fragilité du temps et de l’homme
Idée : La poésie d’Hélène Dorion nous dit qu’il faut prendre le temps de vivre, de saisir l’instant car tout peut basculer vite.
Argument(s) : Pour la poète, la poésie est un exercice de lenteur, éloignée de l’agitation quotidienne, ce qui la rend d’autant plus nécessaire dans notre société déboussolée et en quête de spectaculaire.
Exemple(s) : Le haïku, forme poétique brève née au Japon, composé de trois vers brefs cherche aussi à capturer un instant éphémère et un émerveillement. Le langage poétique, quelle que soit sa forme, est propice à cette saisie fondée sur une contemplation
II. La poésie doit réarticuler notre rapport au monde
A) Les conditions d’écriture du recueil
Idée : Hélène Dorion explique que c'est le confinement de 2020 qui a présidé à l’écriture de ses poèmes ainsi qu’un violent incendie vécu aux USA.
Argument(s) : La conscience écologique s’est renforcée au moment où nos seuls liens avec le monde passaient par les écrans. Il s’agit donc de réfléchir sur notre manière d’habiter le monde. Pour Hélène Dorion, le paysage est le support d’une rêverie et surtout d’une intense réflexion sur la planète et ses enjeux.
Exemple(s) : Hélène Dorion esquisse ainsi, en fin de volume, une réécriture de l’histoire de la planète. Avec la partie "le Bruissement du temps", rythmée par trois sections "d’avant", "Avant l’aube", "Avant l’horizon", "Avant la nuit", elle retrouve la forêt du temps et semble réécrire la Genèse avec le commencement où il n’y avait « ni dieux ni hommes » puis « il y eut un soir et il y eut un matin ». Son but est très clair : inscrire la Nature dans une temporalité pour faire prendre conscience de l’agression que, nous, humains, nous faisons subir, et cela depuis toujours, à la nature que nous habitons.
B) L’arbre comme métaphore de notre intériorité
Idée : L’arbre, son écorce, sa présence sont, dans ce recueil, une métaphore de notre intériorité
Argument(s) : Le rapport entre l’intérieur et l’extérieur, entre nous et le monde
Exemple(s) : Le recueil se clôt sur : "Mes forêts sont un long passage / pour nos mots d’exil et de survie […] / et quand je m’y promène / c’est pour prendre le large / vers moi-même." Le mouvement de cette citation va du personnel, de l’intime "mes" vers le nous pluriel "nos" et se referme sur le "moi" de la poète. Il ne s’agit pas pour elle de faire une description réaliste des lieux où elle vit, des forêts québécoises, mais de dire ce qu’elles sont pour elle, ou ce qu’elles sont à travers elle, comme elle les voit, ou les ressent, ou les éprouve. Le leitmotiv "mes forêts sont…" qui revient 40 fois dans le livre renseigne plus le lecteur sur le "je" qui regarde, que sur les forêts regardées. De même, Rimbaud décrit la mer dans "Marine" des Illuminations, avec des images terrestres, et y voit bien autre chose que ce qu’il a sous les yeux : un monde fait d’autres mondes et d’autres paysages.
Retrouvez l’intégralité du corrigé de l’épreuve de français pour la première générale sur digiSchool.fr.
Bac de français 2024 : sujet corrigé de techno
Les sujets de l’épreuve anticipée en français de la voie technologique portent sur les objets d’étude "Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle" et "La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle".
Sujet officiel de l’épreuve de français 2024 en voie technologique
Cette année, le sujet du bac de français en technologie est composé :
- d’un commentaire de texte sur Anima de Wajdi Mouawad (2012) ;
- d’une contraction sur l’extrait du texte d'après Manon Paulic, "Le défi de l'éducation" dans "L'IA va-t-elle nous remplacer ?" et la réalisation d’un essai dont le sujet est « Une bonne éducation peut-elle se passer d'« emmagasiner des connaissances » ? », en lien avec l’œuvre au programme Gargantua de Rabelais ;
- d’une contraction sur le texte de Mélanie Semaine, "Restons polis ! Mais pourquoi ?" et la réalisation d’un essai dont le sujet est "Pensez-vous que les marques de sociabilité comme la politesse nous empêchent de connaître les hommes tels qu'ils sont ?", en lien avec l’œuvre au programme Les Caractères de La Bruyère ;
- d’une contraction sur un article d'après Marie-Eve Thérenty, "De La Fronde à la guerre (1897-1918) : les premières femmes reporters", et la réalisation d’un essai dont le sujet est "En quoi le fait d'écrire est-il une arme dans la lutte pour l'égalité ?", en lien avec l’œuvre au programme Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges.
Correction de l’épreuve de français 2024 du bac technologique
Le commentaire de texte à réaliser (20 points)
Le texte se présente à la première personne : c’est un oiseau qui raconte une histoire traumatique. Alors qu’elle débute une migration, elle va être prise dans un orage et séparée des autres oiseaux. Après avoir heurté une voiture, des humains vont la prendre en charge.
Nous nous demanderons en quoi ce récit surprenant d’une grue permet de mettre au jour un monde dangereux.
I. Un monde dangereux
Argument 1 : Le texte est construit sur plusieurs oppositions qui renforcent la dangerosité du monde dans lequel évolue l’oiseau car il va lui arriver plusieurs événements inattendus.
Début du texte marqué par une dimension positive et rassurante pour l’oiseau :
- Expérience de l’oiseau en tête de la nuée qui est une présence rassurante. Elle va être suggérée à plusieurs moments du texte : "guidée par la plus âgée de notre nuée" (l. 1-2) ; "la plus prodigieuse et la plus âgée, qui a connu toutes les migrations, qui a niché au nord comme au sud". On peut noter l’usage des superlatifs "la plus âgée" répété deux fois pour produire un effet d’insistance, puis "la plus prodigieuse" qui insiste sur la valeur de ce personnage et l’admiration que les autres grues lui portent. La grue de tête est expérimentée et a une bonne connaissance des flux migratoires ("tous les" / "nord comme au sud"…).
- Beau temps présent au départ : "nous entraînait en direction du soleil" / "aux confins des lumières". Le vol des oiseaux paraît, au départ, paisible : "nous volions très haut dans le ciel".
Mais très rapidement, les oiseaux vont être confrontés à une toute autre réalité. Le texte insiste sur la brutalité du changement qui s’instaure :
- "tout à coup" ( l.3), "soudain, sans nous avertir" (l.12), "Sans attendre" (l.13).
- Opposition temps dégagé / orage : "nous entraînait en direction du soleil vers un point déterminé de l’horizon d’où tout à coup est parti un vent mauvais". La personnification du vent par l’adjectif "mauvais" suggère à lui seul ce retournement de situation.
Argument 2 : Un monde marqué par une violence à laquelle l’oiseau ne peut échapper.
- Champ lexical de la violence et de la brutalité : grand nombre d’occurrences dans le texte. Par exemple, en parlant des autres grues prises dans l’orage : "plusieurs se sont désarticulées dans le ciel noir, emportées, projetées, le cou en vrille, ballottées sans vie, cassées, défaites dans les gifles de la tempête", (énumération avec gradation de tous les états dans lesquels se trouvent les grues malmenées par l’orage et ce, jusqu’à la mort. Personnification de l’orage avec le nom "gifles" qui accentue la violence. Cette dangerosité des éléments qui se déchaînent trouve son apogée quand les grues, perdant le contrôle car peu expérimentées, "explosaient contre la terre".
- La violence est accentuée par le fait que bientôt le personnage se trouve isolé : on peut noter qu’au départ l’accent est mis sur le groupe ("la nuée") avec, notamment, l’usage du pronom personnel "nous". La scission dans le groupe est visible dans la suite du texte, provoquée par la violence des événements météorologiques, par l’usage du "je" qui s’opposent au déterminant "leurs" par exemple : "je devinais la débâcle de mes compagnes", "rouvrir leurs ailes".
II. Un récit surprenant
Argument 1 : Le récit original d’un oiseau, l’oiseau comme double de l’homme.
Argument 2 : La surprise du lecteur qui découvre son monde par l’œil d’un animal
Sujet B - La Bruyère, Les Caractères, livre XI "De l'Homme". Parcours : peindre les Hommes, examiner la nature humaine.
Voici, une proposition de contraction de texte du bac de français en voie techno (10 points) :
Contraction du texte de Mélanie Semaine, "Restons polis ! Mais pourquoi ?" dans L'Éléphant n° 43, juillet
2023.
La politesse est un masque qui cache les pensées des individus. L’évolution du monde vers des sociétés plus policées n’est pas positive pour Rousseau, car elle empêche l’individu d’exprimer librement sa vraie nature. Comment l’expliquer ?
C’est le désir de plaire aux autres qui nous pousse à abandonner nos spécificités pour être intégré au lieu de rechercher une forme de justesse morale en nous-même. Par conséquent, la politesse nous condamne à abandonner ce qui nous caractérise au profit d’un collectif.
À une politesse hypocrite s’oppose donc, pour Rousseau, la recherche d’une réelle expression de soi et de découverte de valeurs individuelles par lesquelles tous les hommes pourraient ensuite s’accorder. Pourquoi alors valoriser une civilité de façade ?
Il paraît difficile de préconiser l’effacement total de la politesse dans nos sociétés. L’individu n’a pas un accès constant à son intériorité et peut donc se tromper sur ce qu’il ressent. Par ailleurs, cette politesse assure une communication apaisée, mettant en sourdine des émotions virulentes source de discordes. L’expression de chaque individualité écarterait de manière définitive les individus et rendrait impossible la création d’un collectif.
La politesse est donc une sociabilisation obligatoire pour une vie en communauté. Loin d’être mensongère, elle est un gage de concorde entre les individus qui la compose.
Mots : 225
Et son essai (10 points) :
Étude du sujet : le sujet est en lien direct avec la contraction qui offre déjà un avis nuancé sur la question. La difficulté est donc de ne pas oublier de faire référence à La Bruyère et de ne pas répéter uniquement la contraction dans le sujet d’essai.
Mots-clés du sujet :
Marques de sociabilité comme la politesse : "les marques de la sociabilité" renvoient à tout ce qui est acquis par l’individu pour être capable de vivre en société. En ce sens, on retrouve des oppositions habituelles chez Rousseau notamment d’état de nature et d’État de droit, c’est-à-dire ce qui est inné chez l’individu (sa nature profonde) et ce qui est acquis (appris dans la société dans laquelle il vit que cela soit positif ou négatif). En ce sens, on retrouve une autre opposition également présente dans le sujet : individu et collectif. En effet, c’est comme si en étant confronté au collectif, l’individu était "marqué", c’est-à-dire "transformé" pour pouvoir s’intégrer. En ce sens, la marque de sociabilité peut être comprise à la fois comme positive : elle permet de s’intégrer, mais aussi comme négative, en ce sens qu’elle obligerait l’individu à prendre un pli qui n’est pas le sien (comme on marque une feuille) et donc en un sens renoncer à soi.
Le sujet en précisant "comme la politesse" oriente la réflexion, mais ne le limite pas complètement. Avec La Bruyère, on peut penser à d’autres marques de sociabilité, comme la mondanité.
La fin de la citation : "empêchent de connaître les hommes tels qu’ils sont" suggère une dimension négative de cette sociabilité, mais pose le candidat, par le verbe "connaître", dans une position similaire à celle de La Bruyère dans ses Caractères. À son tour, il est invité à réfléchir sur cette tension entre individuel et collectif, et à observer la nature humaine…
I. Les marques de sociabilité empêchent de connaître les hommes tels qu’ils sont.
Argument 1 : Les marques de la sociabilité effacent les spécificités de l’individu au profit d’un collectif. L’homme par les marques de la sociabilité efface ce qu’il est pour s’adapter à ce que la société aimerait qu’il soit. Cela empêche donc bien de le connaître.
Argument 2 : La société modèle l’individu et le marque. Le défigurant progressivement et l’empêchant d’être ce qu’il est
II. Les marques de la sociabilité ne sont pas seulement négatives. Elles sont constitutives de toute humanité. Et si elles ne permettent pas forcément de comprendre l’homme, elles permettent de comprendre « les hommes ».
Argument 1 : Les marques de sociabilité permettent de connaître les hommes dans le sens où une rencontre devient possible. L’homme n’est plus seulement tourné vers lui-même et ses propres désirs.
Argument 2 : Les marques de la sociabilité sont une des marques importantes (même si parfois négatives) de l’humanité. Elles font que l’homme est homme.
Consultez l’intégralité du corrigé de français de première technologique sur digiSchool.fr.