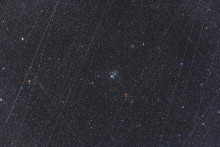6 min de lecture
VIDÉOS - 60 ans de la Nasa : retour sur une folle histoire en 6 moments marquants
La Nasa, agence spatiale américaine, fête ses 60 ans le 1er octobre. Soixante années de conquête spatiale, d'échecs, de succès, de petits pas prometteurs... et de grands pas retentissants.

Le logo de la Nasa (image d'illustration).
Crédit : STAN HONDA / AFP
Je m'abonne à la newsletter « Infos »
Agence pionnière et novatrice, en tête de file de la conquête spatiale, la Nasa est aujourd'hui l'agence spatiale dont les missions les plus importantes et les plus grosses découvertes ont été réalisées sous son logo. Mais cela n'a pas toujours été le cas.
Fondée en 1958 par le président américain Dwight Eisenhower, la National Aeronautics and Space Administration (Nasa) reprenait les fondations de la Naca (National Advisory Committee for Aeronautics), l'agence fédérale de l'époque, chargée de la recherche en aéronautique.
Face à la montée en puissance de l'URSS qui, à ce moment-là, testait avec succès sa première mission spatiale (la fusée Spoutnik, en 1957) et la première mise en orbite d'un être vivant (la chienne Laïka, en 1957 également), la Nasa se devait de rattraper l'énorme retard des Américains dans le domaine de la conquête spatiale.
À l'occasion de la célébration de ses 60 ans, la Nasa a ouvert sa banque d'archives au grand public. On peut ainsi se replonger dans l'histoire des découvertes de l'agence spatiale américaine. Même si les inventions de la Nasa en termes technologiques ont changé certaines choses dans la vie de tous les jours sur Terre, c'est l'exploration spatiale qui fascine le plus.
Avec le développement de l'aéronautique et des nouvelles technologies, les agences spatiales révolutionnent le vol et la prise de pouvoir de l'humanité sur les corps du système solaire. La Nasa a officiellement ouvert ses portes le 1er octobre 1958. Retour sur tant d'années de conquête, d'échecs et de succès.
1. Le programme Apollo, début de la grande aventure
La première et plus fascinante des expériences réalisées par la Nasa est sans conteste celle de la mission Apollo. Et c'est sous la présidence de John F. Kennedy, que la recherche et les programmes spatiaux deviennent une priorité. Le président propose, en 1961, l'ambitieux objectif "d'atterrir un homme sur la Lune à la fin des années 1960, et de le ramener en toute sécurité sur Terre".
Le 12 septembre 1962, John F. Kennedy prononce son discours, devenu célèbre, sur la création du programme : "Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours du siècle (...) non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile".
Le programme Apollo voit donc s'envoler les trois astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, des hommes posent le pied sur la Lune, le 20 juillet 1969.
Cette mission est également la troisième mission habitée, après Apollo 8 (qui a emmené William Landers, James Lovell et Franck Borman en orbite autour de la Lune) et Apollo 10 (qui était en réalité une dernière répétition avant Apollo 11 et qui a permis à Thomas Satfford, John Young et Eugene Cernan de s'approcher à seulement 15,6 km de la surface lunaire).
Le programme Apollo permet ainsi aux États-Unis de prendre la tête de la course à l'espace. Forte de ses nombreuses expériences de mise en orbite et d'envoi d'être humain hors de l'orbite terrestre, la Nasa commence, dans les années 1970 et 1980, un programme de navette spatiale. La première navette, Columbia, décolle le 12 avril 1981.
C'est également à cette période que la conquête spatiale commence à être vue moins comme un terrain de concurrence, mais comme l'occasion de réunir les nations. Les interactions inter-états commencent.
2. 1985 : la naissance de l'ISS
En 1973, après avoir emmené l'Homme dans l'espace, la Nasa veut lui permettre d'y rester. La première station spatiale est née dans les années 1960 : Skylab. Mais trop de retard est pris du côté des navettes spatiales (qui auraient notamment permis sa maintenance et la relève de l'équipage). En 1979, les équipes font rentrer la station dans l'atmosphère où elle est détruite.
Dans le même temps, l'URSS prend de nouveau de l'avance sur les États-Unis avec les stations spatiales Saliout (1974-1991) et Mir (1968-2001). En 1983, Ronald Reagan, alors président des États-Unis, relance un projet de station spatiale dédiée à la recherche scientifique et occupée en permanence. Le coût de la future station s'élèvera à 8 milliards de dollars et sera réalisée en partenariat avec d'autres agences étrangères (l'Esa d'abord, puis le Canada et le Japon).
Pour l'agence spatiale, cette station doit avoir pour but la recherche expérimentale : laboratoire scientifique, observatoire astronomique, assemblage d'engins spatiaux... Parmi les découvertes scientifiques faites dans l'ISS, certaines d'entre elles sont majeures : la fragilité du corps humain, qui ne peut pas supporter la microgravité sur le long terme, la contamination interplanétaire qui pousse à la prudence à chaque contact avec une nouvelle planète ou un nouveau corps céleste, les rayons cosmiques et la matière noire (qui sont, encore aujourd'hui, des sujets d'étude pour les scientifiques)...
La construction de la Station spatiale internationale (ISS) débute en 1998 et des expansions permettent d'augmenter sa taille continuellement (les dernières s'étant achevées en 2016).
Grâce à l'ISS, une énorme collaboration entre les pays permet de mener des recherches et des expériences en permanence dans l'espace, et de continuer à programmer des voyages d'êtres humains en dehors de l'orbite terrestre tous les 6 mois, grâce à la fusée Saturn-V et le vaisseau spatial Orion.
Mais l'exploration de l'espace par l'Homme ne s'arrêtera pas là : la Nasa prévoit de construire des habitats spatiaux profonds à grande échelle, tels que le Nautilus-X et le Deep Space Gateway, dans le cadre de son programme NextSTEP (Next Space technologies for exploration partnerships). De plus, en 2016, elle a reçu l'ordre du gouvernement américain d'amener des humains sur Mars d'ici 2033.
3. Des échecs fracassants
Mais conquérir l'espace n'est pas sans danger. Très vite, les premières catastrophes apparaissent : les navettes spatiales Challenger, en 1986, puis Columbia, en 2003, explosent toutes les deux, la première 74 secondes après son décollage, la seconde moins de 10 minutes après son retour dans l'atmosphère terrestre.
Ces deux accidents, qui ont fait un total de 14 morts, ont non seulement marqué les équipes de la Nasa, mais également le monde entier. Lors du journal de 20h sur TF1, le 1er février 2003, la présentatrice Claire Chazal est au bord des larmes pour annoncer à la France entière l'échec de la mission Columbia et la perte de ses 7 passagers.
4. Sondes, rovers... les nouvelles lubies de la Nasa
Hormis le rover piloté lors de la mission Apollo 15 en 1971 (baptisé le Lunar Roving Vehicule et ayant facilité l'exploration des astronautes à la surface de la Lune), là encore, la Nasa doit répondre d'un gros retard sur les astromobiles. Alors que l'URSS envoie Lunokhod, son tout premier rover sans pilote sur la Lune en 1970, la Nasa n'envoie le sien que 16 ans plus tard. Mais encore une fois, les États-Unis décident de frapper fort : le premier rover américain n'ira pas sur la Lune, mais sur Mars.
Au total, quatre rovers seront envoyés par la Nasa dans le cadre de l'exploration spatiale : Sojourner (en 1996, il survit 7 jours), Spirit (2003-2010) et son jumeau Opportunity (2013-), et Curiosity (2012-). Ils devraient être rejoints en 2020 par deux autres rovers : le "Mars 2020" de la Nasa, et le "Rover Exomars" de l'Esa.
Côté sondes et satellites, la Nasa a été plus généreuse : 28 missions ont été engagées depuis la toute première sonde, Pioneer 1, envoyée en 1958 dans l'espace. Suivirent diverses sondes, atterrisseurs et orbiteurs envoyés aux quatre coins du système solaire : Vénus, Mercure, Jupiter et même les lunes de ces planètes ont été survolées. À ce jour, 8 de ces missions sont encore en cours.

Les missions robotiques de la Nasa
Crédit : CC Wikipédia
5. Aller dans l'espace pour redécouvrir la Terre
L'avancée de la technologie n'a pas seulement permis à l'agence spatiale américaine d'aller à la conquête de lieux inconnus. Elle a également facilité la compréhension d'un monde que nous connaissons déjà bien : la Terre. Grâce aux satellites envoyés en orbite terrestre basse, une certaine hauteur de vue peut être prise par l'Homme dans l'analyse et l'exploration de la planète bleue.
Lancé en 1958, la mission Explorer, qui comprenait quatre satellites, a été la première à aider l'Homme à comprendre le fonctionnement de la Terre (en réponse à Spoutnik). Elle a permis de découvrir l'existence d'une ceinture de particules énergétiques piégées dans le champ magnétique terrestre, connue aujourd'hui comme la ceinture de Van Allen.
La mission Explorer est aujourd'hui la plus longue mission de l'histoire spatiale puisque des satellites rattachés à ce programme sont encore envoyés dans l'espace en 2017, pour un total de 99 missions accomplies. Parallèlement, le dernier satellite en date envoyé en orbite terrestre permettra de mesurer la couche de glace sur la Terre.
6. L'histoire continue...
Aujourd'hui, la course à l'espace continue pour la Nasa, malgré l'arrivée de sociétés spatiales privées sur le terrain, telles que SpaceX, et la montée en puissance d'autres agences spatiales internationales, comme l'ISRO (l'Organisation de la recherche spatiale indienne) qui, en partenariat avec la Chine, a déjà envoyé un rover sur la Lune. La privatisation du domaine de l'aéronautique constitue un coup dur pour l'agence. Mais cette dernière n'en a pas fini avec la recherche spatiale : le budget 2018 alloué par Donald Trump à la Nasa s'élève à plus de 20 milliards de dollars.