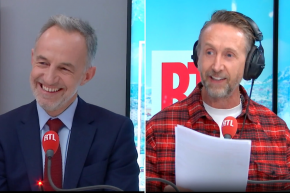2 min de lecture
Grâce présidentielle et amnistie : deux notions à ne pas confondre
ÉCLAIRAGE - François Hollande a accordé la grâce présidentielle a Jacqueline Sauvage. Cette grâce est toutefois partielle puisqu'elle diminue la peine sans l'annuler.

Le ministère de la Justice, place Vendôme à Paris, le 25 mars 2010
Crédit : LOIC VENANCE / AFP
Je m'abonne à la newsletter « Politique »
L’affaire Jacqueline Sauvage a fait beaucoup de bruit autant au sein de la classe politique qu'auprès de l'opinion publique. Celle qui a assassiné son mari après avoir été victime de violences conjugales durant 37 ans avait écopé de 10 ans de prison. Après avoir reçu les filles de cette dernière à l’Élysée, François Hollande a décidé d'accorder une remise gracieuse à la condamnée.
Le président de la République a fait usage de la grâce présidentielle pour diminuer la peine de Jacqueline Sauvage. Cette grâce intervient quand tous les recours judiciaires ont été épuisés. Seul le président de la République peut l’accorder, comme il est écrit dans l’article 17 de la Constitution française de 1958. Elle peut conduire à une libération immédiate ou une réduction de peine, ce qui est le cas pour Jacqueline Sauvage. François Hollande lui a accordé une grâce partielle de "2 ans et 4 mois ainsi que l'ensemble de la période de sûreté qui lui reste à accomplir".
Comment s'y prendre ?
La grâce présidentielle, peut être demandée par le condamné, par son avocat ou ses proches. Dans certains cas comme celui de Jacqueline Sauvage, des associations et des personnalités peuvent se mêler au débat. D'ailleurs, une pétition demandant que la grâce lui soit accordée a circulé et récolté 400.000 signatures. Sur son compte Twitter, Christiane Taubira a également donné son opinion sur la question.
Le recours est analysé par la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces du ministère de la Justice (DACG) avant d’être transmis à la présidence de la République qui donnera la décision finale. Si la grâce est accordée, le décret est contresigné par le premier ministre et le ministre de la Justice. Il est ensuite notifié directement au condamné sans paraître dans le Journal officiel. Le président n’a pas a se justifier de sa décision ni auprès du gouvernement ni auprès du Parlement.
La grâce présidentielle était à l’origine individuelle, puis devient collective dans les années 1980 sous François Mitterrand qui avait pris l’habitude d'accorder des remises de peine collective dès 1991 à l’occasion du 14 juillet. Ainsi, 3.000 à 4.000 détenus en moyenne se voyaient graciés chaque année. En 2008, la grâce présidentielle redevient individuelle sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
Grâce totale ou amnistie
La grâce présidentielle est partielle puisque qu’elle tend à réduire
la peine du condamné dans le respect de la justice et non à l’annuler. Elle se différencie de l’amnistie. Cette notion envisage l’oubli total du crime. Elle consiste à effacer le caractère d’infraction donc supprime la condamnation. Ces conséquences sont en somme plus importantes. L’amnistie s'apparente ainsi à une grâce totale relevant de la compétence exclusive du Parlement.
Les cas de remises gracieuses
Plusieurs cas ont marqué l’histoire de la remise gracieuse comme le cas du jardinier Omar Raddad, condamné à dix-huit ans de prison en 1994 pour le meurtre de sa patronne. Il avait toujours nié l’acte et reçoit finalement la grâce de Jacques Chirac en 1998. Nicolas Sarkozy pour sa part a accordé sa grâce à l’ancien préfet du Var, Jean-Charles Marchiani, inculpé pour trafic d’influence et recel d’abus de biens sociaux. Une grâce qui avait suscité une vive polémique et avait été accordée à près de trente autres condamnés.
- Jacqueline Sauvage : "François Hollande a l'art de brouiller les cartes d'invitation", dit Pascal Praud
- Jacqueline Sauvage : "Une affaire exploitée par tous", dénonce Éric Zemmour
- Jacqueline Sauvage : ses filles invitées au dîner pour Raul Castro, le couac de l'Élysée
- Jacqueline Sauvage : "François Hollande est comme Louis XVI, il est humain, alors comme il est le roi, il lui accorde la grâce", dit Alain Duhamel
- Jacqueline Sauvage graciée : "Un archaïsme total", selon le magistrat Dominique Coujard