4 min de lecture
Bac 2016 : ce qu'il fallait écrire dans votre copie de philosophie
INVITÉE RTL - Alors que 500.000 élèves ont passé l'épreuve tant redoutée de philosophie ce 15 juin, retour sur les sujets avec une professeur du lycée Paul-Bert, à Paris.
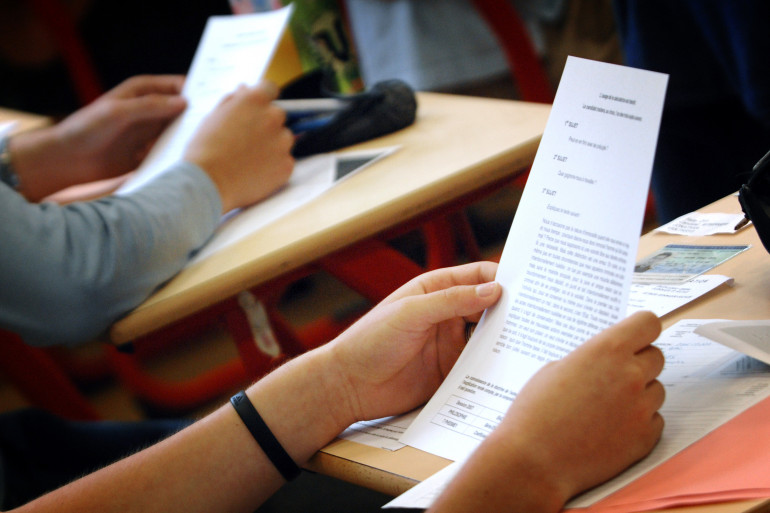
Des copies pour une épreuve du Bac (illustration)
Crédit : MARTIN BUREAU / AFP
Je m'abonne à la newsletter « Infos »
Le top départ du baccalauréat a été donné avec l'épreuve de philosophie pour 500.000 lycéens ce mercredi 15 juin. Après avoir passé quatre heures dans une salle d'examen à réfléchir sur une question autour du désir, de l'histoire ou des convictions morales, il y a ceux qui ne veulent plus entendre parler du sujet sur lequel ils ont planché et puis il y a les autres, impatients de savoir si leur écrit correspond aux attentes des correcteurs.
Agathe Richard, professeur au lycée Paul-Bert à Paris, a livré ses premières pistes au micro de RTL. Pour les dissertations, l'enseignante rappelle les fondamentaux. À savoir : citer deux auteurs et diviser sa démonstration en trois parties. Le correcteur s'attend à ce que l'étudiant "se pose des questions, fasse des définitions, s'interroge sur les mots qui sont présents dans le sujet. Je n'ai pas l'impression d'avoir une marge de manœuvre quand je corrige une copie. Avoir bien compris le sujet est essentiel", explique Agathe Richard, avant de passer en revue les différents sujets proposés à chaque section : L, S, ES et technologique.
"Nos convictions morales sont-elles fondées sur l'expérience ?"
C'est le sujet "coup de cœur" d'Agathe Richard. La professeur de philosophie insiste : "Tous les sujets du bac mettent en relation les notions qui ont été étudiées par les élèves, ici c'est la morale et l'expérience, et puis il y a les mots repères, ici le fondement s'oppose à l'origine."
L'enseignante ajoute que "les convictions viennent de l’expérience, elles viennent de notre vécu parce que les convictions sont des croyances dans des valeurs que l'on a incorporées, il faut aussi se demander d'où vient la morale." L'Express complète : "Ce qui est en question ici ce sont les choses que nous faisons et à quoi nous attachons la conviction que nous devons le faire, que ça doit être fait, et cela, pour des raisons fort solides et qu'on pourrait éventuellement entreprendre d'expliquer."
"Le désir est-il par nature illimité ?"
"Le désir est-il par nature illimité ?" "Là, c'est le 'par nature' qui compte. Le désir se distingue du besoin. Les besoins sont définis, déterminés par la nature. Le désir n'est pas déterminé donc il n'a pas de limite. Ici, le "par nature" est l'équivalent de l'essence, est-ce-que c'est ce qui définit le désir ? On pousse le candidat à se demander comment on va définir le désir et essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de limite."
"Pour être juste, suffit-il d'obéir aux lois ?"
"Pour être juste, suffit-il d'obéir aux lois ?" Comme pour chaque sujet de philosophie, analyser la sémantique de chaque mot est capitale pour saisir la question. Agathe Richard note : "Le rapport entre la justice et le droit, dire 'oui', obéir aux lois c'est être juste et puis contrarier le sujet en insistant sur la distinction entre légal et légitime. Légal, c'est ce qui est conforme au droit et légitime, c'est ce qui va vraiment être juste." Pour la justice, la professeur conseille de citer Socrate, qui explique "qu'il faut toujours être juste et il a le souci d'obéir aux lois même quand elles le condamnent à mort."
"Pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire ?"
C'est le deuxième sujet qui était proposé aux élèves de la section ES. Pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire ?" "Dans "avoir intérêt", il y a quelque chose de menaçant?", fait remarquer Agathe Richard. Studyrama.com ajoute que "chacun sait en effet que c'est l'ignorance des causes et des effets des difficultés qui explique souvent nos erreurs. Oui, mais ici se pose un problème car nous savons aussi que la culture ne résout pas tout et qu'elle n'est pas toujours ce qui fait que les hommes se comportent bien", avant de citer l'exemple de l'Allemagne nazie ou de l'Europe de l'entre-deux-guerres.
Le site aurait développé sa dissertation en trois parties : "ne pas s’embarrasser" avec l'histoire car c'est le passé (en citant Les Pensées de Pascal, qui craint que l'on passe à côté du présent), se "méfier" de l'histoire et se demander de quelle histoire on parle (attention à la propagande) et étudier l'histoire pour "connaître ce qui est vrai".
ne résout pas tout et qu'elle n'est pas toujours ce qui fait que
"Travailler moins, est-ce vivre mieux ?"
Travailler moins, est-ce vivre mieux ? "Le travail, selon l’étymologie, c'est un instrument de torture. Vivre mieux, c'est la notion de bonheur. C'est une référence à Thomas More dans L'Utopie, où il dit ce serait pas mal d'égaliser un peu le travail, dans la mesure où beaucoup de gens sont oisifs et d'autres se tuent au travail. Faire que chacun travaille six heures par jour pour que tout le monde vive mieux." Pour le travail, citer Karl Marx est un plus.
Roger Pol-Droit, philosophe et chroniqueur au Monde des Livres, propose sa version et cite Nietsche, qui distingue la vie, le plaisir et le travail, le labeur et qui plaide pour une baisse du temps de travail pour augmenter la qualité de la vie (exemple avec les congés payés et le Front populaire) "Le travail consomme une extraordinaire quantité de forme nerveuse et la soustrait à la réflexion, à la méditation, à la rêverie, à l'amour et à la haine." Mais "moins de travail, c'est moins de revenus" et donc vivre moins bien et pas mieux.
- Bac 2016 : le travail, le désir et l'histoire... Les sujets de l'épreuve de philosophie
- Bac 2016 : que faire en cas de retard, absence ou oubli ?
- Bac 2016 : que manger et boire pendant les examens
- Bac 2016 : ce qu'il ne faut pas oublier le jour de l'examen
- Bac 2016 : ces cas de fraude les plus improbables
- Réviser son bac avec l'Euro de football





